L’indémodable et universelle brique LEGO, traduit par « joue bien » en danois, fait une fois de plus parler d’elle. On connaissait son pouvoir d’inclusion pour attirer et rassembler toutes les générations. Depuis quelques années, une déclinaison appelée « LEGOthérapie » a fait son apparition. Axée sur une approche thérapeutique, l’idée est de favoriser l’apprentissage grâce à une activité ludique, et ce, dès le plus jeune âge. L’outil permet concrètement de travailler certaines compétences chez les tout-petits comme la mémorisation, le partage, la concentration, la motivation ou encore les relations sociales.
L’entreprise danoise a développé depuis quelques années les « Lego Braille Bricks », disponibles en Belgique, qui permettent à tout un chacun d’« apprendre le braille de manière accessible grâce à LEGO ». Par ailleurs, le jeu a aussi été décliné par un certain docteur Dan Legoff en 2004 sous forme d’outil thérapeutique, initialement développé pour les personnes diagnostiquées avec un trouble du spectre autistique (TSA). Depuis lors, la « LEGOthérapie » est utilisée à tout âge et semble prendre tout son sens pour développer les apprentissages grâce au jeu auprès des tout-petits.
Comment fonctionne la LEGOthérapie ?
Un atelier de LEGOthérapie est tout d’abord mené par une personne de référence, bienveillante et qui détermine un programme adéquat en fonction des participant.e.s. Ce professionnel peut être un psychologue, orthophoniste, ergothérapeute, orthopédagogue, psychopédagogue ou encore un éducateur. Une séance se réalise idéalement avec la présence de trois participants appelés respectivement « l’ingénieur » (qui possède le manuel et décrit la construction), « le fournisseur » (qui écoute les instructions et trouve les bonnes pièces) et « le constructeur » (qui construit grâce aux pièces du fournisseur et aux instructions de l’ingénieur). Bien sûr, la thérapie peut également se faire en séance individuelle en fonction de l’âge et des objectifs visés. En effet, l’outil convient à tous les âges et il pourra être utilisé en complément pédagogique d’autres séances. La « LEGOthérapie » aidera les tout-petits à développer des compétences comme le vocabulaire ou l’attention et les motivera à réitérer l’expérience lors d’une prochaine séance d’apprentissage.
Des bienfaits certains
LEGO est avant tout un jeu qu’il semble pertinent de détourner vers de l’apprentissage ; tel est l’objectif de la « LEGOthérapie ». D’ailleurs, il est indispensable d’annoncer aux participants qu’il s’agit bien d’un exercice et non pas d’un simple jeu. Comme on peut le lire sur le site d’Ideereka (Site de ressources pédagogiques spécialisés pour les dys, tdah, tsa et proposant une formation sur la LEGOthérapie) : « En effet, certains, en voyant les briques de couleur, vont espérer pouvoir jouer. Or, l’objectif est surtout de développer plusieurs habiletés. En effet, si cette thérapie s’appuie sur un jeu pour développer des compétences, elle nécessite un cadre thérapeutique pour faciliter ces apprentissages. Les aptitudes suivantes peuvent alors être travaillées : la cohésion de groupe, le tour de rôle dans une discussion, le partage, la résolution de problèmes (de manière individuelle et collective), la mémorisation, l’attention, le champ lexical descriptif (couleurs, formes, tailles…) et, donc, le langage expressif (ce que l’on dit) ainsi que le langage réceptif (ce que l’on comprend), la motricité fine, ou encore la théorie de l’esprit (qui est une aptitude cognitive qui nous permet de comprendre les états mentaux des autres personnes). »
Se former à la LEGOthérapie
Il existe un organisme français, créé en 2015, appelé « Ideereka », abréviation de « idée » et de « Eurêka », qui développe des ressources pour les enfants, adolescents et adultes à besoins spécifiques. Le site met à disposition du matériel en libre accès, des articles et propose également des formations en ligne (payantes).
→ Pour en savoir plus sur la formation à la LEGOthérapie par « Ideereka »
→ Pour en savoir plus sur LEGOthérapie ↓
Samuel Walheer









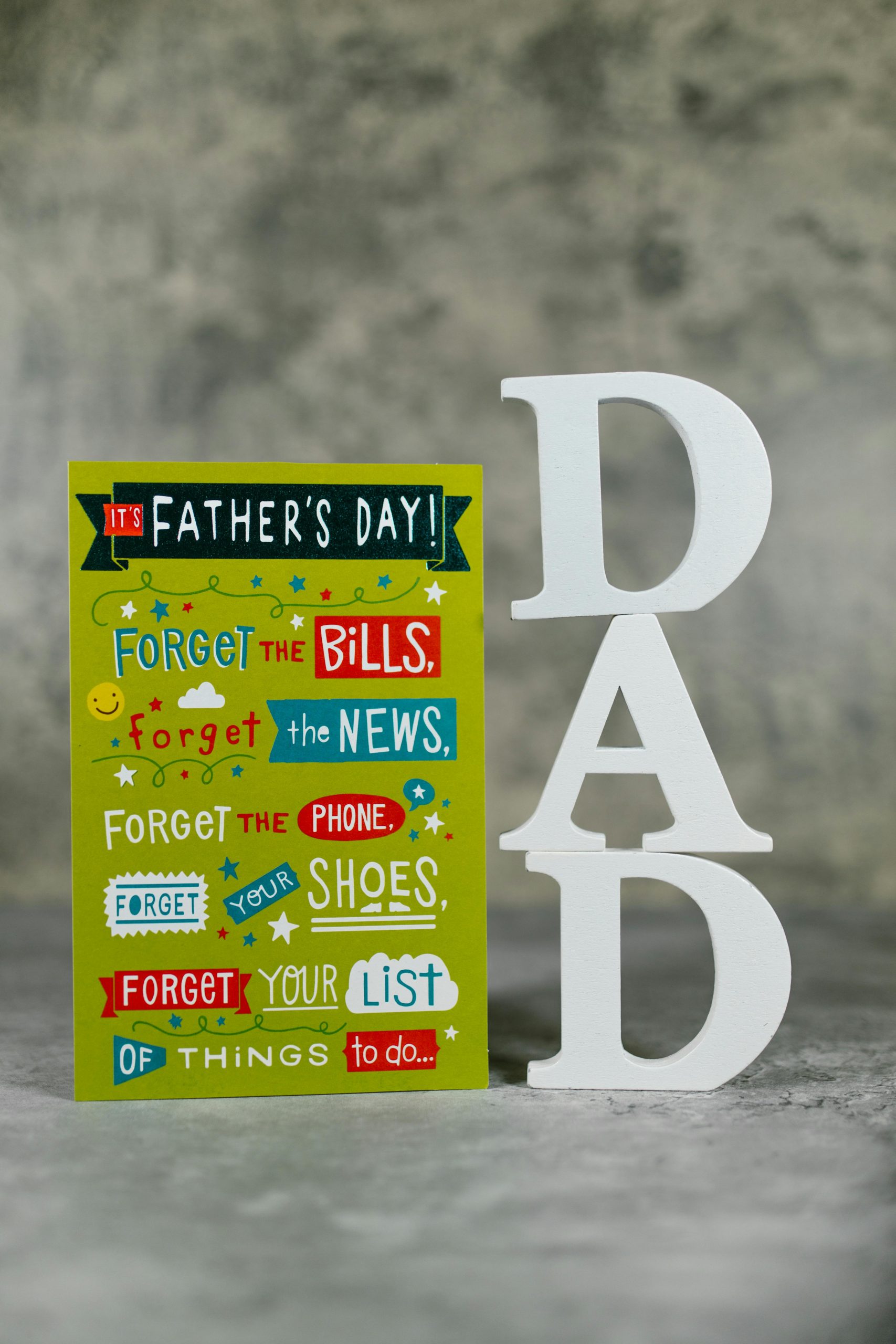 Origine et expansion de la fête
Origine et expansion de la fête