La Ligue des familles partage sa toute dernière étude intitulée « Où ouvrir prioritairement de nouvelles places en crèche ? ». Au programme, l’analyse de la situation actuelle et les difficultés de nombreuses familles, au regard d’un constat : la Fédération Wallonie-Bruxelles a perdu 1.700 places en crèche ces quatre dernières années. L’étude formule également des propositions qui permettraient de créer de nouvelles places dans des zones dites « en tension »; là où la (forte) demande ne rencontre pas l’offre (trop faible).
Pour l’équipe de Born in Brussels, le bien-être des bébés et de leurs parents est capital. Et cela commence par la possibilité d’accéder à toutes les formes de gardes possibles ; les crèches en priorité. On le sait, au plus tôt les démarches sont entamées (à partir du 4e mois de grossesse), au plus nombreuses sont les chances de voir son enfant inscrit dans une crèche ou chez un.e accueillant.e agréé.e par l’ONE. Car les places en crèches sont convoitées par de nombreuses (futures) parents et limitées en fonction de la situation géographique. À cet égard, plusieurs articles ont été publiés comme : Manque de places en crèche : la Ligue des familles crée une cartographie en soutien aux (futurs) parents ou 770 places en crèche de moins qu’en 2019 : “une situation dramatique pour les familles”. En vue d’améliorer la situation, la Ligue des familles partage son analyse de la situation et ses recommandations pour le secteur.
D’après le baromètre 2024 de la Ligue des familles, 61% des parents disent avoir difficile ou très difficile à trouver une place dans un milieu d’accueil pour leur enfant. 33% n’ont pas trouvé de places en crèche au moment où ils en avaient besoin, et 23% des parents doivent prendre un congé parental, réduire voire arrêter leur activité professionnelle faute de place en crèche. »
Le taux de couverture
Le taux de couverture (en places subventionnées) désigne le nombre de places en crèches qui appliquent des tarifs proportionnels aux revenus des parents et au regard du nombre d’enfants âgés de 0 à 2,5 ans dans une zone géographique donnée. Cela signifie que les nouvelles places sont ouvertes là où le taux de couverture est faible ; là où il y a peu de crèches accessibles par rapport au nombre de bébés. Seulement voilà, on crée des places là où il y en a le moins, mais sans tenir compte des zones où la demande des parents est la plus forte. Pour la Ligue des familles, ce critère est pertinent mais il requiert une condition : « On n’ouvre plus de nouvelles places dans les zones géographiques où le taux de couverture est certes plus élevé que la moyenne, mais où la demande des parents est aussi particulièrement forte. De plus, les budgets prévus pour la création de nouvelles places en crèche ne permettent pas de répondre dans l’immédiat à tous les besoins. Il est donc nécessaire de déterminer où il est prioritaire d’ouvrir les prochaines places. »
Que propose la LDF ?
La Ligue des familles propose d’utiliser une partie des nouveaux budgets dédiés à la création de places (par exemple 10 ou 20%) à l’ouverture de nouvelles crèches dans les zones en tension, où la demande non rencontrée des parents est la plus forte. Cela comblerait les manquements et simplifierait la vie des familles. De plus, la LDF préconise, à court terme, un plus grand investissement dans le développement de nouvelles places en crèche. À long terme, elle souhaite qu’un financement de projets voit le jour pour favoriser les places en crèche de manière permanente. En ce sens, l’analyse faite par la Ligue démontre que cela permettrait :
• D’éviter la brièveté des délais pour rentrer les projets, ce qui peut conduire à les préparer dans l’urgence ;
• La constitution d’une liste d’attente pour les projets non retenus dans un premier temps, évitant ainsi leur déclassement et la nécessité de devoir réintroduire un nouveau dossier (avec la charge de travail que cela représente) ;
• D’inciter au développement de milieux d’accueil, fussent-ils non financés dans un premier temps, qui seraient cependant considérés comme finançables à terme, une fois qu’ils auront été sélectionnés selon leur classement dans la liste d’attente évoquée dans l’analyse.
Il faut développer à la fois des réponses très concrètes à court terme –pour répondre aux besoins des familles qui
recherchent actuellement une place– et à plus long terme –pour les familles qui auront des enfants dans les mois et années à venir. »
Soutenir le secteur
La Ligue des familles partage ses propositions dans l’espoir que les demandes de développement, de stabilisation et de revalorisation du secteur aboutissent dans le futur. Pour soutenir le secteur, la LDF espère, d’une part, qu’il y ait une amélioration des conditions de travail des puéricultrices, notamment à travers une prise en compte de la pénibilité spécifique à ce métier. D’autre part, elle souhaite la mise en application d’un meilleur financement du personnel dédié à l’encadrement ; à savoir 1,5 ETP (équivalent temps plein) pour 7 enfants, au lieu de celui d’1 ETP pour 7 enfants. Pour ajuster les politiques en matière de petite enfance au regard des situations de nombreuses familles confrontées à des difficultés, l’analyse de la Ligue des familles prend tout son sens et fait figure d’une réelle proposition de travail.
Samuel Walheer



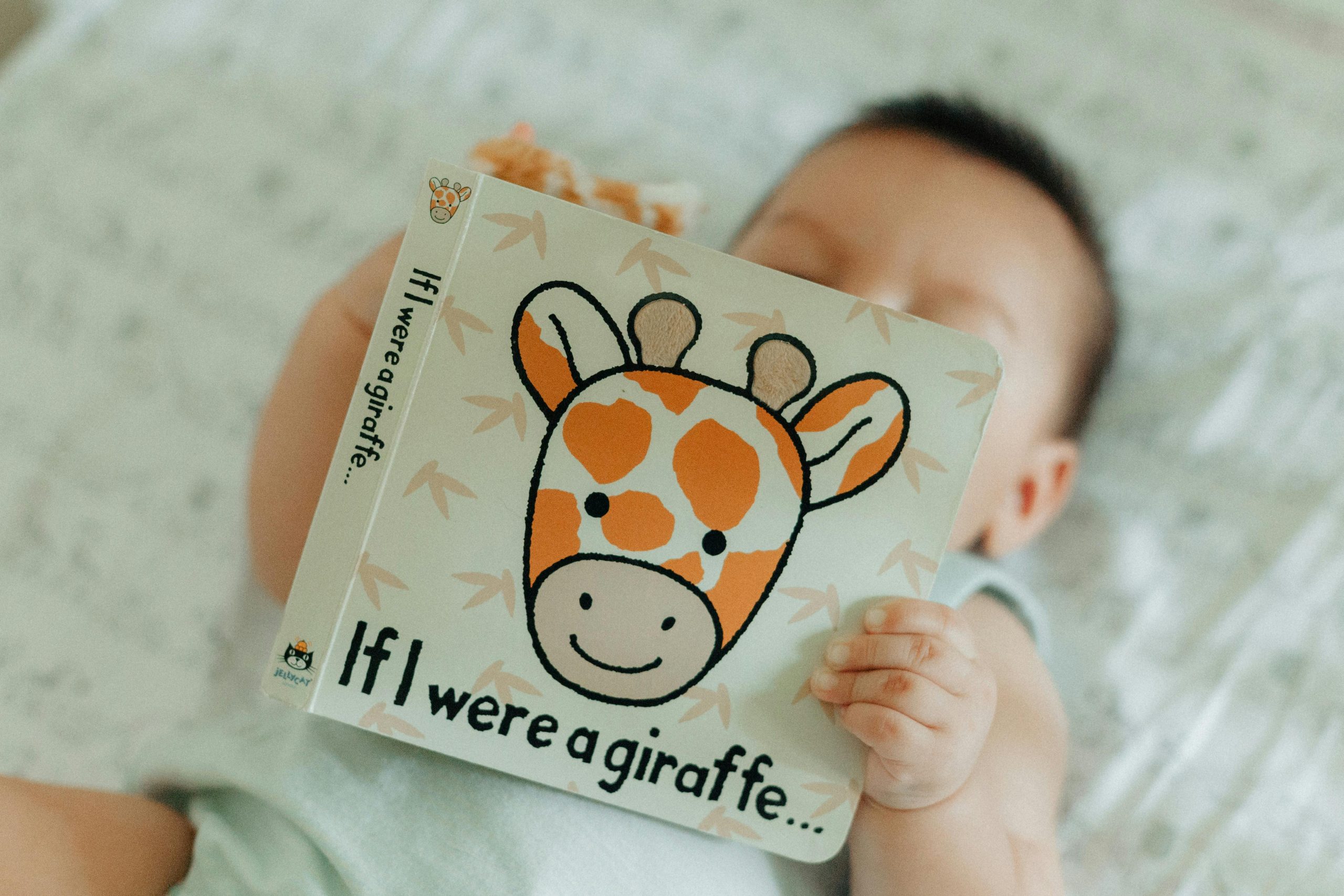
 Quel que soit son lieu de naissance, le bébé va conserver la ou les langues qu’il entend le plus régulièrement. C’est ce qu’on appelle l’élagage. Cela signifie que le bébé utilise toute son imagination et perçoit une multitude de possibilités, dans une action, qui se singularisent avec le temps. Erika Parlato-Oliveira traduit cela par un exemple concret : « La façon dont on manipule les objets. Le bébé va prendre la cuillère et sera capable de faire une musicalité avec alors qu’en tant qu’adulte, nous serons plus rationnels et verrons l’objet par son utilité première, celle de manger. Le bébé explore donc constamment, ce qui relève d’un travail que l’on imagine très fatiguant. » Les bébés imaginent donc des choses, font des hypothèses et les vérifient ensuite tels des petits chercheurs.
Quel que soit son lieu de naissance, le bébé va conserver la ou les langues qu’il entend le plus régulièrement. C’est ce qu’on appelle l’élagage. Cela signifie que le bébé utilise toute son imagination et perçoit une multitude de possibilités, dans une action, qui se singularisent avec le temps. Erika Parlato-Oliveira traduit cela par un exemple concret : « La façon dont on manipule les objets. Le bébé va prendre la cuillère et sera capable de faire une musicalité avec alors qu’en tant qu’adulte, nous serons plus rationnels et verrons l’objet par son utilité première, celle de manger. Le bébé explore donc constamment, ce qui relève d’un travail que l’on imagine très fatiguant. » Les bébés imaginent donc des choses, font des hypothèses et les vérifient ensuite tels des petits chercheurs.

