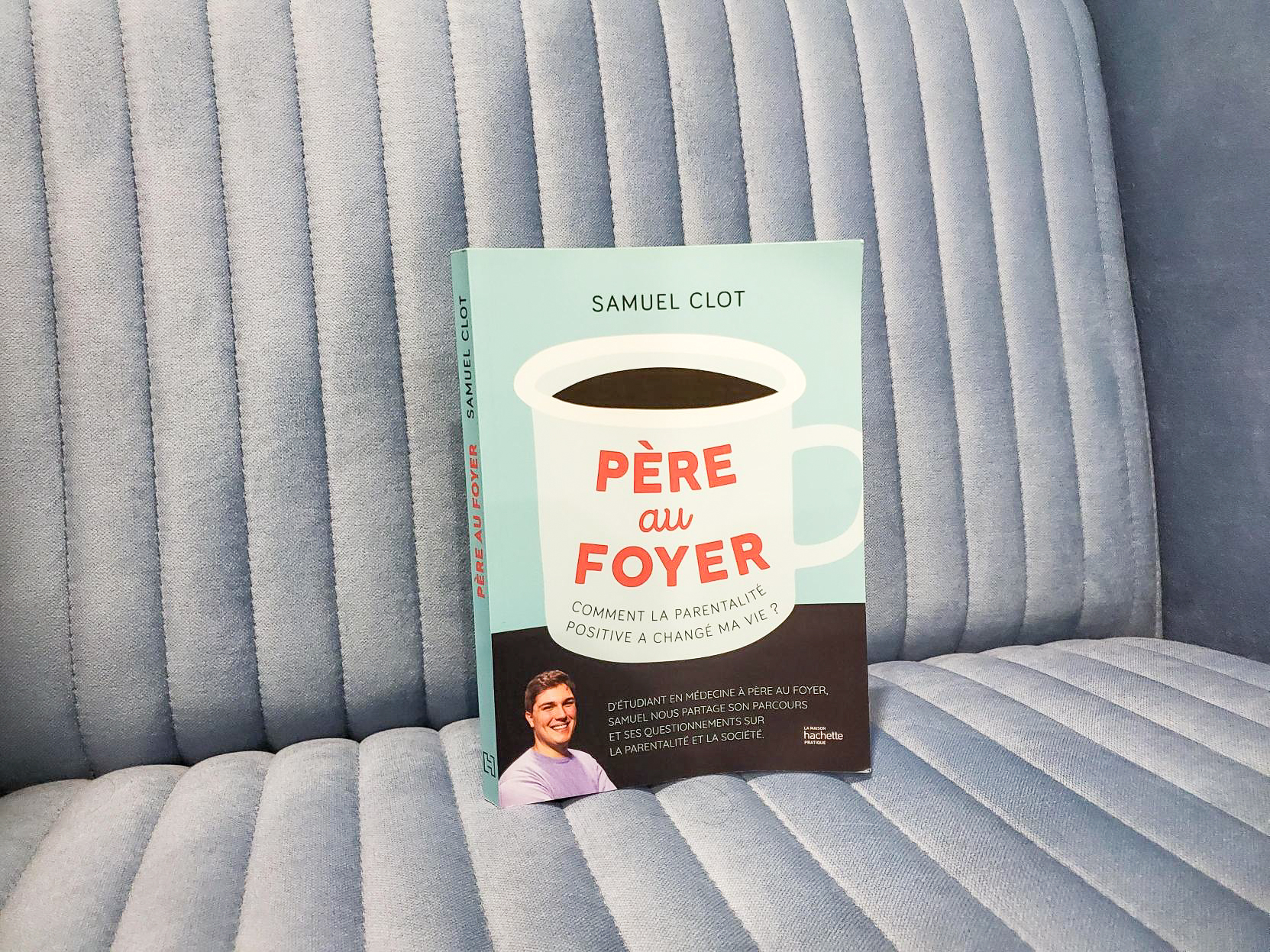Tout récemment à Londres, un groupe de papas a accroché des poupées, mises dans des portes-bébés, à des statues de personnalités publiques. Il s’agit d’un mouvement appelé « The Dad Shift » créé expressément pour revendiquer la révision du congé paternité; un allongement et une meilleure rémunération. Une action symbolique et pleine de sens. Cela fait d’ailleurs écho chez nous en Belgique où les (futurs) papas sont à peine mieux lotis pour accueillir leur bébé et accompagner leur conjointe dans leur nouvelle aventure. Le débat est donc bel et bien relancé !

D’après une étude récente partagée par le journal britannique The Guardian, le Royaume-Uni propose l’une des plus mauvaise condition de toute l’Europe en termes de congé de paternité. De ce fait, un père sur trois ne profite pas de son congé paternité par crainte d’avoir des soucis financiers. En Belgique, d’après les chiffres de l’INAMI (Institut National d’Assurance Maladie Invalidité) et de l’INASTI (Assurances sociales pour les travailleurs indépendants), le nombre de pères qui prennent leur congé de naissance est en augmentation depuis ces dernières années.
Nous voulions que ce soit un spectacle un brin provocateur. On pose souvent des questions aux femmes sur leur vie d’épouse, de mère et de fille, alors que les hommes connus ne sont souvent pas invités à partager cette partie d’eux. Nous voulions attirer l’attention sur leur rôle de père et plus globalement sur la nécessité de mieux soutenir les personnes qui ont des bébés dans leur vie, a indiqué George Gabriel, l’un des cofondateurs de « The Dad Shift », au journal The Guardian.
The Dad Shift

Actuellement, les nouveaux papas britanniques disposent de seulement deux semaines de congé de paternité. Le groupe « The Dad Shift » a donc été formé pour, d’une part, permettre d’allonger ce congé. D’autre part, afin de montrer toute l’importance des liens qui peuvent exister entre un père et son enfant et ainsi, soutenir l’équité entre les parents. Pour l’occasion, l’action visait donc à marquer l’attention du grand public et, particulièrement des jeunes papas. Une campagne forte qui a été accompagnée de messages forts auprès du gouvernement britannique. Preuve en est par une lettre ouverte adressée au Premier ministre Keir Starmer dont voici un extrait : « Vous avez parlé de la distance dans votre propre relation avec votre père, et pourtant de la façon dont il a contribué à façonner le père que vous êtes maintenant devenu. Nous vous demandons d’aider des générations entières de pères à combler ce fossé, de donner aux pères le temps dont ils ont besoin pour passer avec leurs enfants et de déterminer les pères qu’ils veulent devenir. »
Et en Belgique alors ?
Depuis janvier 2023, le congé de paternité et coparentalité est passé de 3 à 4 semaines en Belgique. Une évolution certaine qui aura pris près de vingt ans à voir le jour. Mais l’idée mijotait depuis longtemps en faveur d’un allongement, voire même d’une obligation nécessaire. Car, on le sait, il est indispensable pour un père d’être présent, surtout durant les premières semaines, pour accompagner au mieux la maman face aux difficultés que peut représenter la venue d’un nouveau-né. Suite à cette décision d’allongement, La Ligue des Familles faisait état d’une progression remarquable des politiques, sans pour autant fermer le débat d’un allongement supplémentaire. En effet, dans un article paru en juin 2023, l’équipe de Born in Brussels publiait un article intitulé Un congé de paternité de 15 semaines : cinq partis y sont désormais favorables ! (bornin.brussels).
Dans le reste de l’Europe
La Belgique n’est donc pas la plus mauvaise élève – à l’image de l’Allemagne qui propose un congé parental partagé– mais elle a encore du chemin à faire. Pour 26 des 27 États membres de l’Union Européenne, le congé paternité rémunéré est depuis 2022 un acquis. En effet, celui-ci s’élève à 10 jours ouvrables et à 19 jours en moyenne. En pratique, si l’on jette un coup d’œil auprès de nos voisins, certains sont tout de même plus souples. À l’instar de l’Espagne qui propose un congé de paternité de 16 semaines à tous les nouveaux papas. La Norvège, elle, dispose d’un congé de 10 semaines, les Pays-Bas proposent 42 jours et, le plus généreux reste la Suède avec 480 jours de congés indemnisés. Aux jours de congés qui diffèrent s’ajoute également un taux d’indemnisation diffèrent : 100% pour la Pologne et l’Estonie, 78% pour la Bulgarie, 53% pour le Danemark ou encore 20% pour les Britanniques. La Ligue des familles suggérait déjà en 2023 dans une un communiqué de presse d’allonger le congé de paternité de deux semaines par an dès 2024, pour arriver à 15 semaines d’ici 2029. Christophe Cocu, Directeur général de la Ligue des familles déclarait à ce sujet « L’Espagne, où le congé de paternité dure 16 semaines, l’a fait. Et d’autres pays d’Europe sont encore loin devant nous, comme la Norvège (10 semaines). Il s’agit d’une proposition réaliste, si la volonté politique y est »
Vers un congé paternité obligatoire ?
Depuis le 2 août 2022, l’Union européenne instaure un congé de paternité rémunéré obligatoire au sein des pays membres (Directive sur l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée). En pratique, la mise en place de ce congé, exclusivement dédié au père ou au deuxième parent dans les pays où la coparentalité, est reconnue mais varie d’un pays à l’autre. À cet égard, La Ligue des familles suggérait aussi dans son communiqué, de rendre le congé paternité obligatoire à l’instar de nos voisins français (1 semaine), portugais (20 jours) ou à l’Espagne (6 semaines). Le Directeur général Christophe Cocu expliquait : « Nous proposons de rendre la totalité du congé actuel (4 semaines) obligatoire, et puis quand ce congé durera 15 semaines, les 9 premières semaines obligatoires, comme c’est le cas pour les mères. Il s’agit de permettre aux pères de prendre ce congé sans craindre de conséquences professionnelles négatives et de réduire les inégalités professionnelles entre hommes et femmes…Et là aussi, la demande des parents est massive puisqu’ils sont 64% à demander un congé de paternité obligatoire et seulement 9% à y être défavorables. »
Samuel Walheer



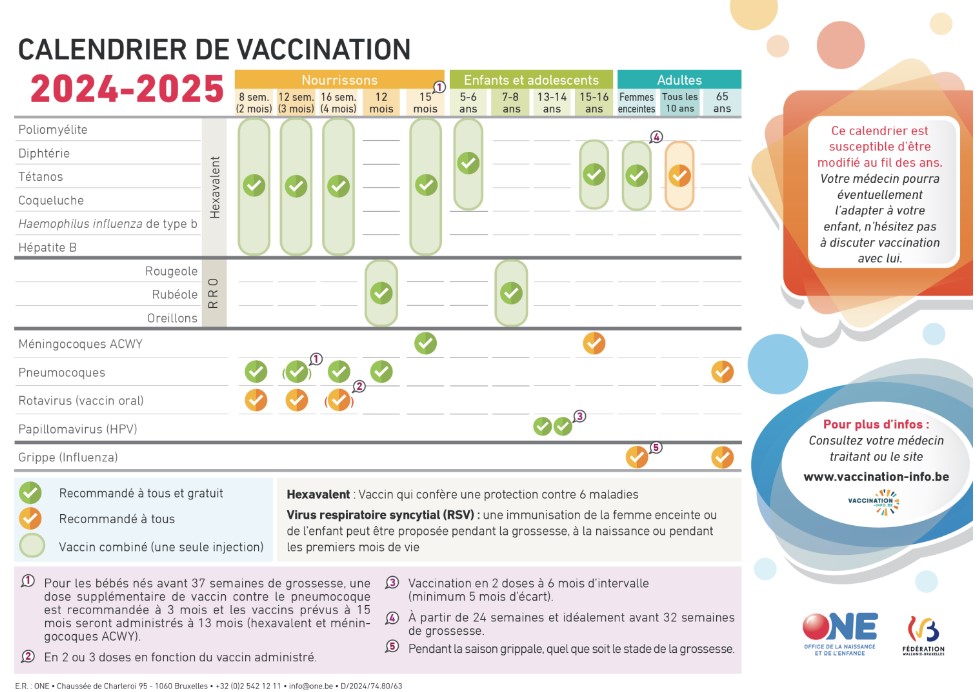



 Comment participer ?
Comment participer ?