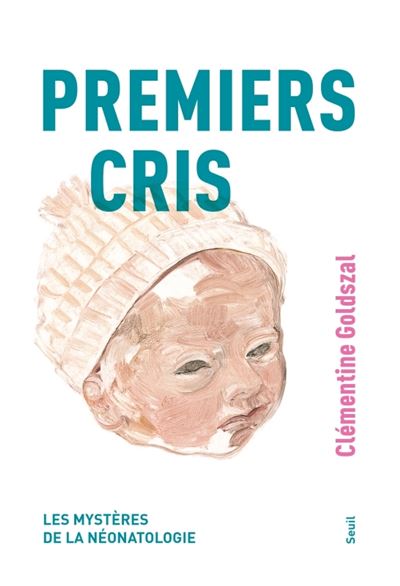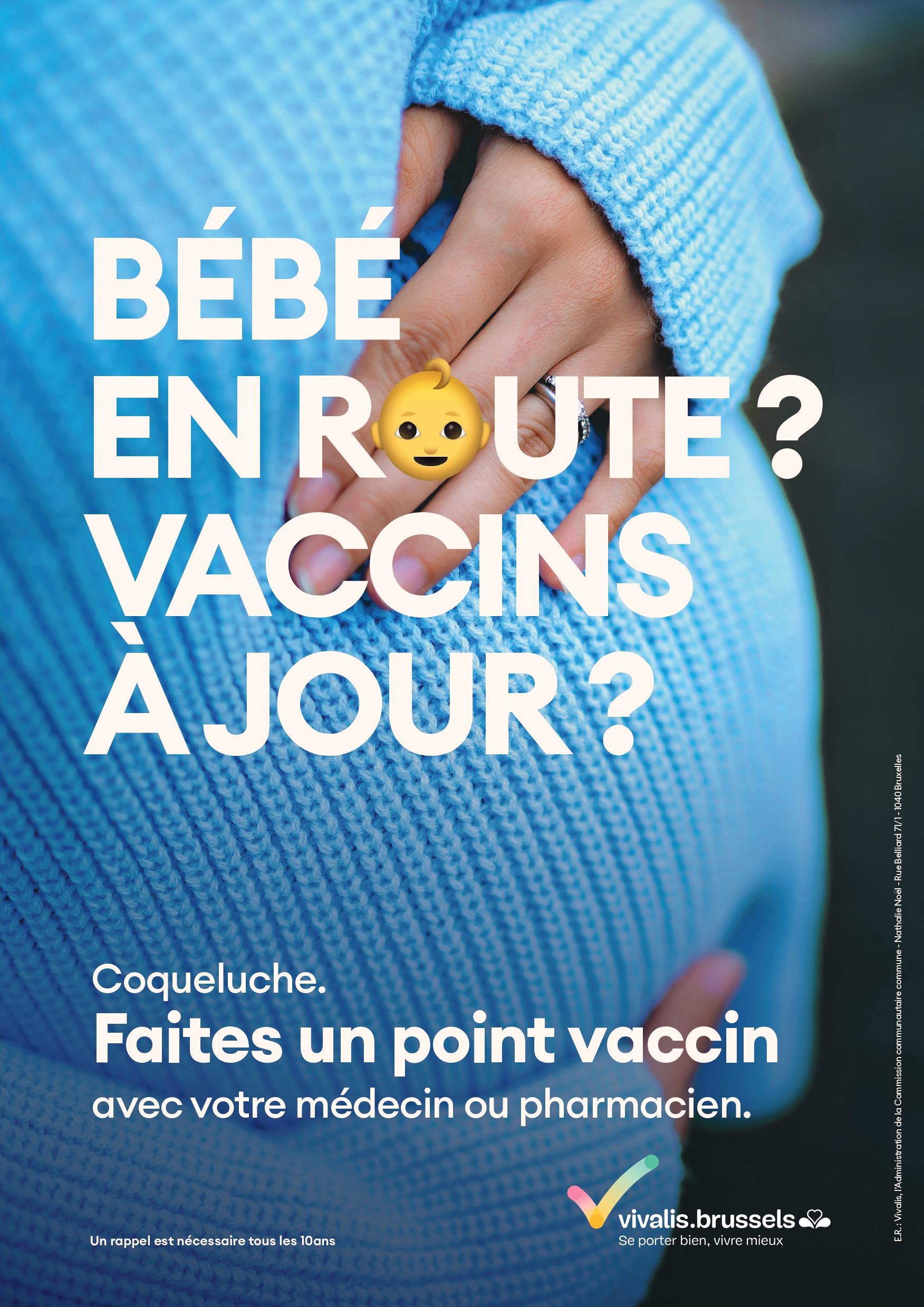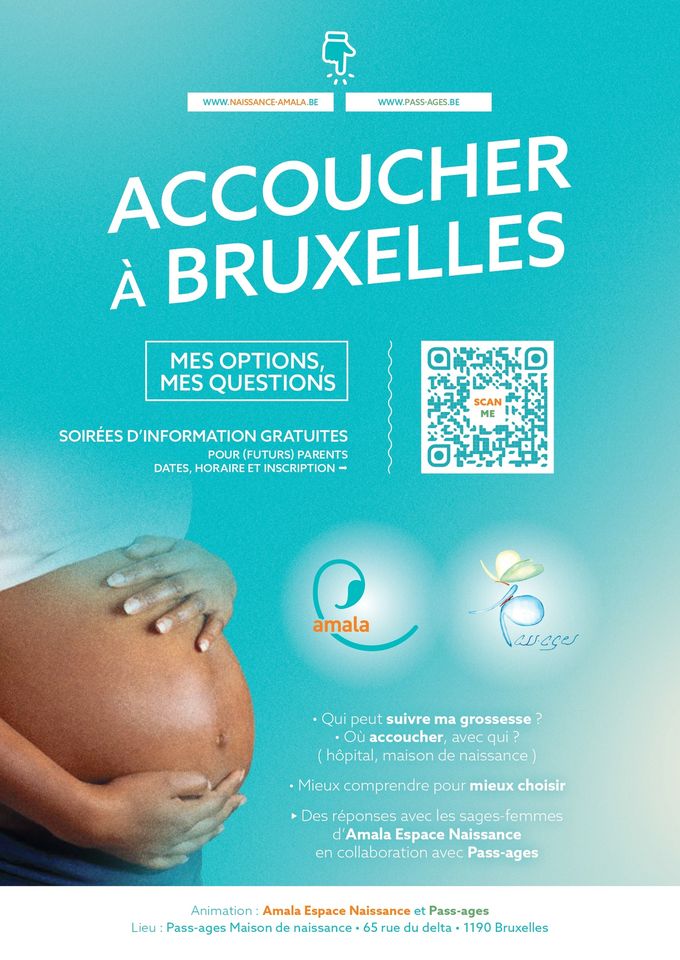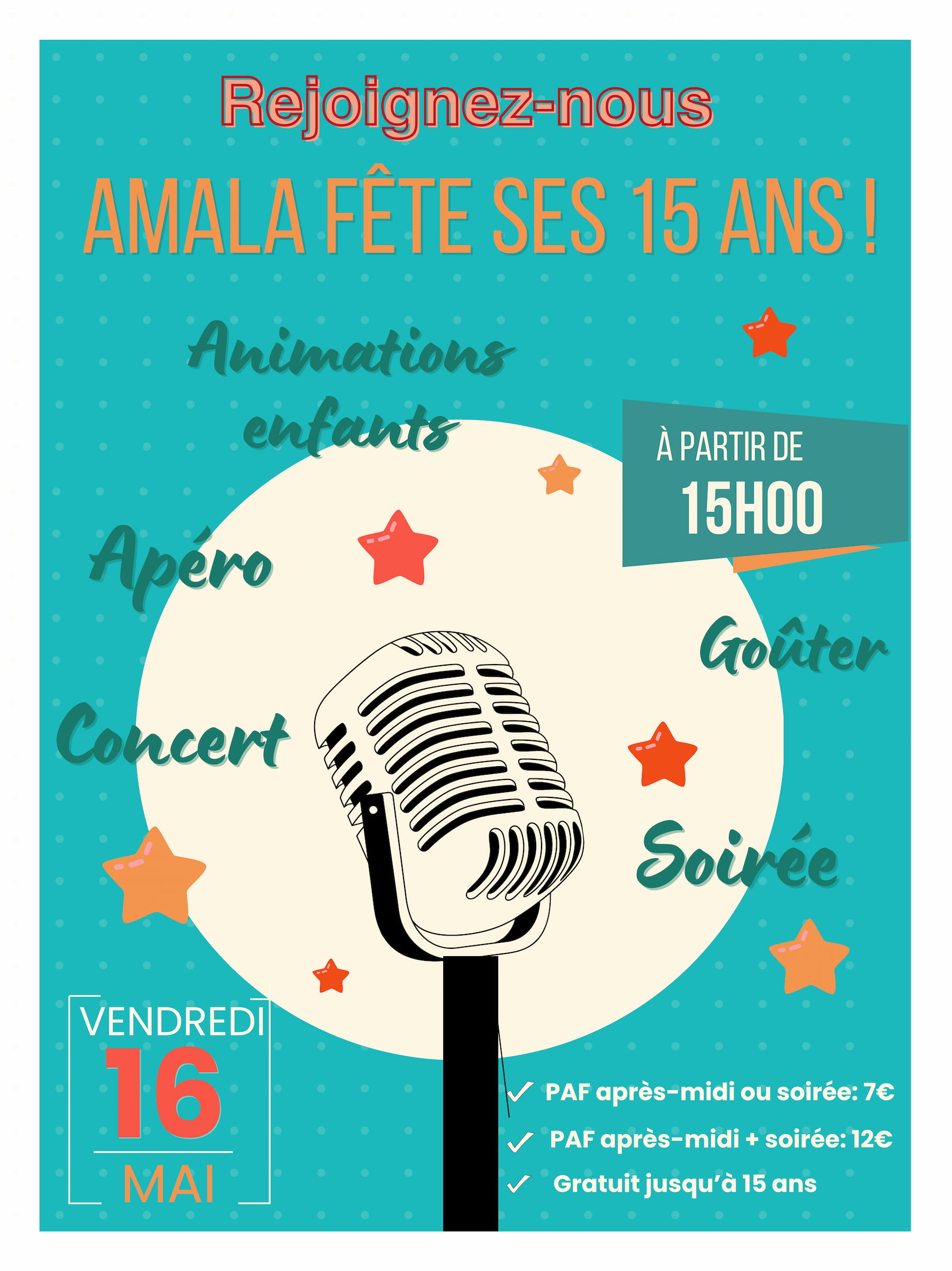Premiers cris, un livre puissant sur le monde de la néonatologie, vient d’être publié aux éditions du Seuil. Pendant plusieurs mois, la journaliste Clémentine Goldszal a effectué une immersion dans le service de réanimation néonatale de l’hôpital Necker-Enfants malades à Paris. Elle a ensuite écrit ce récit qui éclaire avec sensibilité les premiers instants de vie des nouveau-nés.
La périnatalité est le sujet de prédilection de Born in Brussels, voire son unique ligne éditoriale. De nombreux articles sur la néonatologie et la prématurité figurent ainsi sur notre site. Le dernier en date : L’association SOS Préma alerte l’État français sur le combat des parents de prématurés. En terme de littérature, il existe encore peu d’écrits sur ce sujet sensible. En revanche, sur la thématique de la maternité, les auteur.rice.s s’en donnent à cœur joie. Exemple parmi d’autres, un livre-bijou qui exprime enfin ce que c’est vraiment d’« Être mère ».
Raconter l’indicible : la naissance en situation critique
Avant d’écrire son ouvrage (son tout premier), Clémentine Goldszal a intimement partagé le quotidien de ce service de réanimation néonatale, observant les soins, les gestes précis, mais aussi les espoirs et les doutes qui accompagnent ces débuts de vie hors normes. À travers un récit mêlant portraits, témoignages et réflexions, l’autrice cherche à rendre visible cet univers suspendu, où la naissance rime d’emblée avec lutte et incertitude.
« La vérité des nouveau-nés nous échappe. Absolument démunis, non doués de parole… Une énigme entoure leur précieuse existence », peut-on lire dès les premières pages du livre.
Un regard sensible sur la vulnérabilité
Au fil des pages, Premiers cris ne se limite pas à une observation clinique. Clémentine Goldszal mêle à son récit des références issues de la philosophie, de la psychanalyse et de l’art pour proposer une réflexion plus large sur la condition humaine. Comment aborder ces existences fragiles ? Quelle place donner à la vulnérabilité dans une société tournée vers la performance ? Le livre invite à penser autrement ces instants où tout commence.
« Les nouveau-nés communiquent par quelque chose qui est autre chose que le langage », a livré Clémentine Goldszal au sein d’un podcast intitulé « Ce que les nouveau-nés nous révèlent sur la vie ».
Utile autant aux parents qu’aux professionnel.le.s de santé
Sans être un guide pratique, Premiers cris pourrait toucher de nombreux lecteurs. Les jeunes parents, et particulièrement les nouvelles mères confrontées à la prématurité ou à une hospitalisation néonatale, y trouveront peut-être un écho à leurs émotions et à leurs questionnements. Les professionnel.le.s de santé, elles.eux, pourront y retrouver une approche sensible de leur métier, centrée sur le soin relationnel, l’écoute et la présence humaine, au-delà des protocoles techniques.